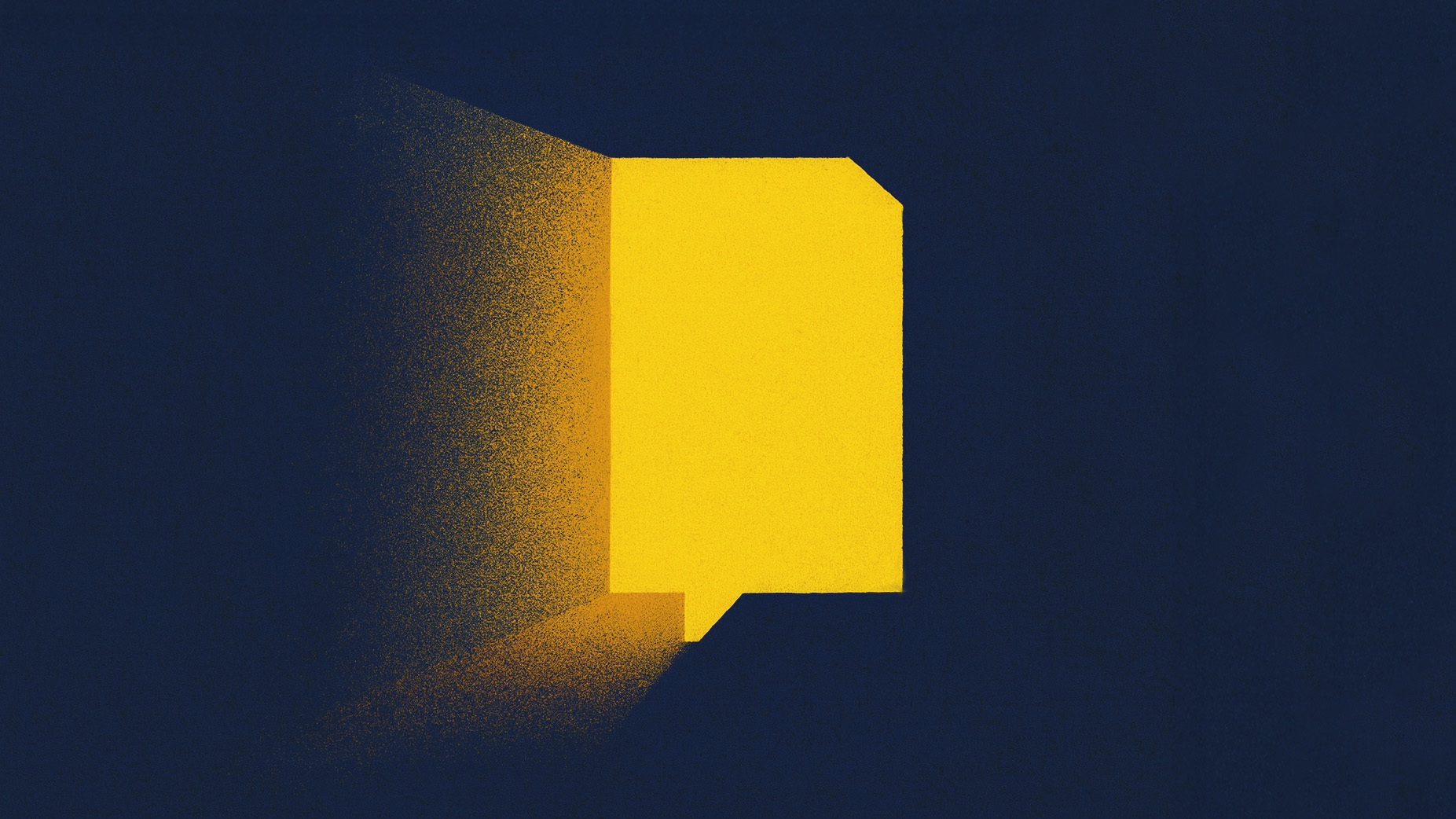Des chaises pliantes à l'hôtel de ville. Du café froid. Les suspects habituels débattent pendant que le reste de la communauté reste sans voix. La participation citoyenne ressemblait à cela autrefois – et dans trop d'endroits, cela reste encore le cas.
Mais à mesure que les attentes des résidents évoluent et que les outils à notre disposition se multiplient, les collectivités locales les plus avisées combinent les méthodes en ligne et hors ligne pour créer quelque chose de meilleur : une stratégie hybride conçue pour avoir un impact.
Participation hybride : un terme, de nombreuses approches
Vous vous demandez encore ce que signifie réellement la combinaison de la participation en ligne et hors ligne ? Vous n'êtes pas seul dans ce cas.
Il n'existe pas de formule unique - et la manière dont vous combinez les méthodes peut faire une grande différence.
Parfois, les méthodes et les formats numériques sont proposés sur place à différentes étapes d'un projet. Par exemple, vous pouvez commencer par une enquête en ligne, puis organiser une assemblée citoyenne et appeler plus tard à la soumission de commentaires.
Dans d'autres cas, les options en ligne et hors ligne sont proposées en parallèle, de sorte que les gens ont le choix de participer à la même phase de la manière qui leur convient le mieux. Un exemple est de répondre à un sondage, soit sur un stand public, soit via une plateforme numérique de participation.
Les deux approches peuvent être efficaces. L'important est de choisir le bon mélange et que cela soit adapté aux objectifs de votre projet, au groupe cible et au contexte.
« Avec la participation hybride, il ne s'agit plus de choisir entre différentes méthodes - il s'agit d'utiliser le bon outil, au bon moment, pour le bon groupe cible, afin de garantir la réussite de vos projets ».
Les avantages d'une stratégie hybride de participation citoyenne
Nous avons tous assisté à ces réunions de planification où les défenseurs du numérique et les champions des méthodes traditionnelles semblent parler des langues différentes. "Nous avons besoin d'une campagne sur les réseaux sociaux !" insiste l'un. "Mais nos aînés comptent sur l'invitation imprimée," rétorque un autre.
Le bon côté d'une stratégie hybride de participation est qu'elle va au-delà de ces faux choix. En combinant les méthodes en ligne et hors ligne, vous pouvez obtenir :
- Une portée plus grande – Plus de personnes seront informées de vos projets si vous les rencontrez là où elles se trouvent ; en ligne, en personne ou les deux.
- L'inclusivité et une meilleure représentation – Accommodez tous les résidents, y compris ceux ayant des barrières à la mobilité ou à la langue, un accès numérique limité, ou des emplois du temps chargés.
- Une participation accrue – Plusieurs options réduisent les frictions et facilitent la participation des gens à vos projets.
- Efficacité en termes de coût et de temps – Les outils numériques réduisent le travail manuel.
- De meilleures données – Recueillez des contributions plus diversifiées et de meilleure qualité.
- Des décisions plus intelligentes – Des retours plus représentatifs conduisent à des politiques qui reflètent mieux les besoins de vos citoyens.
- Une confiance renforcée – La transparence et la réactivité bâtissent des relations durables et de la crédibilité.
Bien que la participation hybride ne soit plus révolutionnaire, il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La clé réside dans la prise de décisions réfléchies sur les méthodes à utiliser, quand les utiliser et comment les combiner pour un maximum d'impact.
Trois étapes pour faire fonctionner la participation citoyenne hybride
Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Voici trois étapes pour concevoir un projet de participation qui livre réellement des résultats.
1. Connaître votre communauté
Avant de lancer une seule enquête ou de programmer une seule réunion, dressez une carte de votre public cible dans votre communauté et de la manière dont ils préfèrent entrer en dialogue avec votre collectivité.
Même l'initiative de participation le mieux intentionné échouera si vous utilisez la mauvaise méthode. Par exemple, compter uniquement sur des outils numériques dans un quartier où de nombreux résidents n'ont pas d'accès Internet de manière fiable exclura des voix importantes. De même, organiser une session de feedback critique pendant la saison des vacances pourrait sembler pratique, mais de nombreux résidents sont probablement trop occupés ou indisponibles pour participer.
Notre conseil : faites comme la Ville de Gand, en Belgique, pour leur projet de budget participatif : créez des "profils ADN de quartier" simples capturant non seulement les données démographiques, mais aussi les préférences de communication et les niveaux de confiance envers le gouvernement. Cette base a orienté leur passage entre méthodes numériques et analogiques tout au long de leur processus de plusieurs mois.
2. Choisir les bonnes méthodes – et les faire travailler ensemble
Une fois que vous comprenez votre public, la prochaine étape consiste à décider comment vous allez les faire participer et comment vous allez communiquer avec eux. Cela signifie choisir des méthodes et des canaux en fonction des personnes que vous essayez d'atteindre, du sujet en question, et des ressources et du temps dont vous disposez.
Une stratégie hybride solide part d'un principe simple : planifiez pour une participation en ligne et hors ligne chaque fois que cela est possible. Si les ressources sont limitées, si un groupe est particulièrement difficile à atteindre numériquement, ou si vous obtenez une forte traction sur un canal, vous pouvez ajuster l'équilibre.
Demandez-vous :
- Qui essayez-vous d'atteindre ? Un citoyen pourrait répondre à un sondage en ligne sur son téléphone, un autre préférerait une discussion rapide au marché.
- Qu'est-ce qui est faisable pour votre équipe ? Votre capacité décide. Si vous ne pouvez faire qu'un seul dispositif correctement, faites-le, mais soyez transparent à ce sujet et cherchez des moyens de combler les lacunes au fil du temps.
- Quels dispositifs de participation sont les plus inclusifs ? Considérez les besoins d'accès, la langue, le confort avec la technologie et la confiance.
- Comment communiquez-vous ? La communication est aussi important que la participation elle-même. Cela pourrait signifier des affiches et des dépliants traduits avec des QR codes, des stories Instagram expliquant comment participer, ou des mises à jour par email.
Conseil : Assurez-vous que votre message, vos visuels et votre ton sont alignés sur tous les canaux. Les gens devraient reconnaître votre projet peu importe où ils le rencontrent.
Et qu'en est-il de la complexité ? C'est un facteur, mais cela ne devrait pas être un obstacle à la numérisation. En fait, avec la bonne configuration, la participation en ligne peut soutenir des discussions nuancées.
3. Apprendre en faisant
Un bon projet de participation ne consiste pas à tout réussir du premier coup. Il s'agit d'écouter, d'apprendre et de s'améliorer à chaque étape. Donc, une fois que votre projet est lancé, prenez le temps de comprendre ce qui fonctionne – et ce qui ne fonctionne pas.
Mesurer le succès commence par les chiffres de participation, mais cela ne doit pas s'arrêter là. Pour obtenir une vue d'ensemble, regardez :
- La portée : Combien de personnes avez-vous touchées – à la fois en ligne et en personne ? Pensez aux flyers distribués, aux participants aux événements, aux visites sur votre plateforme, aux taux d'ouverture des emails.
- La qualité des contributions : Obtenez-vous des réactions superficielles ou des contributions significatives ? Les gens s'engagent-ils entre eux, ou soumettent-ils simplement des réponses individuelles ?
- La représentation : Les personnes qui participent sont-elles représentatives de la communauté au sens large, ou est-ce toujours le même groupe qui se présente ?
- Le sentiment : Quel est le ton général de la conversation ? Les gens sont-ils optimistes, frustrés, confus ? Cela peut vous en dire long sur l'impact du projet.
- La satisfaction : Comment les gens se sentent-ils par rapport au processus lui-même ? Ont-ils compris comment participer ? Le referaient-ils ?
Ce type d'informations vous aide à affiner votre approche, identifier les lacunes et ajuster rapidement. Cela renforce également votre argumentaire en interne. Si vous pouvez montrer que la participation citoyenne a conduit à des contributions plus représentatives, à de meilleures décisions ou à une confiance accrue, il devient beaucoup plus facile d'obtenir du soutien pour les initiatives futures.
Si vous utilisez une plateforme comme Go Vocal, les tableaux de bord intégrés et l'analyse des sentiments alimentée par l'IA peuvent vous aider à suivre tout cela en temps réel. Cela signifie que vous pouvez repérer les problèmes pendant que le projet est encore en ligne et vous adapter en conséquence.
Prêt à mettre la participation hybride en pratique ?
Que vous soyez en train de piloter votre premier projet ou de le déployer à l'échelle de votre territoire, regardez notre webinaire enregistré "Allier le numérique et présentiel pour une participation efficace" pour découvrir des stratégies, des outils et des exemples concrets qui vous aideront à réussir.
Vous pouvez également planifier une démo pour voir comment notre plateforme peut rendre la participation plus fluide, moins coûteux en ressources et plus impactant. Nous serions ravis d'échanger avec vous de la manière dont nous pouvons simplifier et maximiser vos projets de participation !